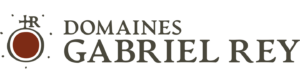26 siècles de viticulture en Vaucluse
Connues des peuples celtes qui occupaient le sud de la Gaule, la culture de la vigne et la production de vin ont été dynamisées par l’arrivée des colons grecs de Phocée, installés dès le début du VIe siècle avant J.-C. à Massalia (Marseille). Du fait de techniques plus évoluées et de cépages peut-être plus productifs d’une part, ainsi que d’un réseau commercial et d’une large diffusion d’autre part, la production de vin paraît ainsi s’amplifier jusqu’à la conquête romaine, période durant laquelle les peuples gaulois et les marchands romains ont commercé en bonne entente.
L’analyse de moût de raisin a révélé que, dès la fin du VIe siècle avant J.-C., les Gaulois habitant le Mourre de Sève, une colline de Sorgues située à quelques kilomètres de Saint-André-des-Ramières, cultivaient la vigne et produisaient du vin. Il aura fallu la découverte puis l’expertise de presque 1 600 restes de pépins et de pédicelles formant le moût de raisin pour faire remonter l’origine du vin en Vaucluse de plusieurs siècles. Les Gaulois du Mourre de Sève cultivaient sans doute le raisin et procédaient à sa vinification dès la fin du VIe siècle avant J.-C. C’est la découverte la plus ancienne actuellement connue en Provence, au-delà des côtes méditerranéennes. Les Gaulois qui vivaient éloignés du littoral n’avaient pas attendu les colons grecs, puis romains, pour devenir vignerons.
Dès l’âge du Fer
Certes, on savait déjà que dès la deuxième moitié du VIe siècle avant J.-C. et surtout à partir du Ve, les vins produits sur les côtes de la Méditerranée circulaient dans des amphores fabriquées à Marseille (amphores massaliotes) jusqu’au cœur du territoire gaulois. Objet de commerce et d’échanges, ce vin était apprécié par ces amateurs de boissons fermentées comme la cervoise. “Le vin était pour eux une boisson exceptionnelle, festive, un peu comme le champagne aujourd’hui, bue dans des vases de prestige d’origines grecque et étrusque”, avancent Pascal Marrou et Maeva Serieys, archéologues, tous deux spécialistes de l’âge du Fer. Si la présence de cette culture particulièrement bien adaptée au terroir local (substrat calcaire, terres caillouteuses et sèches, généralement en pente) était déjà connue, on ignorait jusque-là quelle était sa destination : la corbeille à fruits ou la cuve pour faire du vin ? On savait les Gaulois de l’âge du Fer éleveurs, agriculteurs, métallurgistes et potiers ; ils se révèlent aussi viticulteurs.
Le vin gaulois se diffuse dans tout l'Empire romain
C’est à la faveur d’un conflit entre Gaulois et colons grecs que les Romains colonisent à leur tour le sud de la Gaule vers 125 avant J.-C., puis la Gaule dans sa totalité entre 58 et 51 avant J.-C. Cette conquête génère alors un développement important de la culture de la vigne et de la production de vin : les campagnes du sud de la Gaule se couvrent de domaines agricoles, alors appelés villae, souvent détenus par des colons. Les terres sont ainsi défrichées, drainées et plantées et la capacité de production de vin augmente considérablement, entraînant aux environs du changement d’ère une large diffusion du vin gaulois dans tout l’Empire romain.
Le terroir vauclusien occupait une place importante dans la production vinicole gallo-romaine en raison de la qualité de ses sols, de l’exposition de ses coteaux, mais aussi du fait de sa proximité avec les grands axes commerciaux. Il était en effet traversé par trois grands axes de communication : la voie Domitienne (Via Domitia) joignant les péninsules italiques et ibériques (l’Italie et l’Espagne) ; la voie d’Agrippa reliant Lugdunum (Lyon) à Arelate (Arles) et joignant plus largement le centre de la Gaule et la Méditerranée ; et bien évidemment le Rhône, cette grande voie navigable permettant de diffuser les productions gauloises vers le sud et le pourtour méditerranéen, mais également vers le nord et les confins de l’Empire.
Le Vaucluse, une terre viticole
La présence du fleuve à proximité directe constituait donc un avantage pour les échanges commerciaux, notamment avec l’Italie qui, à cette époque, était très gourmande de vin originaire de Provence. Mais la ferveur italienne pour ces vins allait remettre en cause la qualité de certaines productions comme la Campanie aux abords de Naples. Sur ce, l’empereur romain du moment (Domitien), ordonna que l’on arrache toutes les vignes de la vallée du Rhône et notamment celles du Vaucluse. Ce fut néanmoins une action bénéfique. En effet, quand les vignobles de plaines disparaissaient, les vignobles situés en coteaux progressaient, ces derniers étant de bien meilleure qualité.
Malheureusement, les invasions barbares porteront un coup presque fatal au vignoble. Seules quelques vignes furent cultivées par quelques Gaulois, à l’époque réfugiés dans des oppida (anciennes fortifications gauloises). Cela suffit tout de même pour perpétuer la tradition pendant près d’un demi millénaire.
C’est donc cinq siècles plus tard, aux alentours du VIe siècle, et grâce aux religieux, que les vignobles reprennent de l’importance en terre vauclusienne. Au VIIIe siècle, le pape Grégoire X achète le Comtat Venaissin au roi de France, et une période de stabilité s’installe pour la production viticole dans le Comtat. Elle durera cinq siècles.
C’est en 1309, avec l’arrivée de Clément V en Avignon, que la viticulture connaît une véritable période de prospérité. En effet, il était coutumier à l’époque que chaque pape restaure des vignobles autour de leur château, et ce fut comme cela que naquit le Châteauneuf-du-Pape. Les vins du Comtat étaient pour la plupart vendus en pays d’Aix. Ils prenaient ensuite la direction des Alpes du sud pour y être échangés contre du blé. Certaines vignes sont largement reconnues, comme celle de Châteauneuf-de-Gadagne, à l’époque très largement étendues. Pour dire, au début du XVe siècle, la ville de Carpentras compte une provision d’environ 300 litres de vin pour chacun de ses… 3 500 habitants !
Mais le départ de la papauté du pays d’Avignon (au début du XVe siècle) met un frein à cette belle progression.
Le début des Côtes-du-Rhône
C’est dans le Gard, vers Roquemaure, que naquit le nom de Côtes-du-Rhône. Aujourd’hui sa renommée et sa commercialisation ont largement dépassé les frontières nationales.
Après les débuts gardois, tout va rapidement changer avec le rattachement du Comtat Venaissin à la France, en 1791. C’est là que va naître le département de Vaucluse. Les vignerons de Provence de l’époque n’hésitent pas à “copier” l’appellation gardoise. Les Côtes-du-Rhône étaient nés.
Malgré l’apparition de nombreuses maladies telles les attaques de pyrales, de vers de la grappe et, à partir de 1848, d’oïdium, la vigne devient une source de revenus majeure.
Dans les années 1860, le développement ferroviaire stimule la production. Malheureusement, une terrible maladie de la vigne va tout bouleverser : le phylloxera. Cet insecte piqueur apparenté aux pucerons, venu des Etats-Unis, dévaste notre vignoble. Les paysans s’orientent alors vers des productions telles que le blé, la cerise et l’abricot.
La reconstruction va heureusement se mettre en place, mais désormais il faut greffer la vigne dont la conduite nécessite beaucoup plus de travail. De petites propriétés en polyculture côtoient de grands domaines qui, peu à peu, vont se spécialiser en viticulture.
Et l’histoire n’est pas finie. Au tout début du siècle passé, une crise viticole sans précédent n’épargnera pas les vignobles vauclusiens. Malgré tout cela, l’activité retourne vers une certaine prospérité pendant la Première Guerre mondiale. La vigne s’étend déjà sur de nombreux territoires, et le gel des oliviers de 1956 contribuera largement à son essor.
Ah Châteauneuf-du-Pape ! C’est ici que prit corps pour la première fois la notion d’AOC (Appellation d’Origine Contrôlée devenue Appellation d’Origine Protégée) avec la constitution en 1923, par le baron Pierre Le Roy de Boiseaumarié, d’un syndicat de défense.
Sur la base d’un procès en justice, le baron obtint en 1933 un jugement qui définit et délimite l’appellation Châteauneuf-du-Pape. La même année, avec le gastronome Curnonsky, il fut à l’initiative de la création de l’Académie du vin de France.
Le 12 mars 1935, Joseph Capus déposa sur le bureau du Sénat une proposition de loi qu’il avait élaborée en totale concertation avec le baron Le Roy. Les dispositions de la “Loi Capus” furent ensuite intégrées par Édouard Barthe dans le décret-loi du 30 juillet 1935. La première classification se fait le 15 mai 1936 avec, en concomitance, les vins d’Arbois, Châteauneuf-du-Pape, Tavel, Cassis et Monbazillac. Ce sont les premières AOC pour des vins, complétées de l’eau-de-vie de Cognac.
Gigondas
AOP en 1971
Vacqueyras
AOP en 1990
Rasteau
AOP en 2010 pour les vins rouges secs